Depuis de nombreuses années, les moteurs de recherche tentent d’affiner leurs réponses en utilisant des informations contextuelles liées à l’utilisateur : géolocalisation, historique de recherche, profil personnel, etc. L’avènement du smartphone, terminal plus ouvert que le desktop, a fait progresser cette stratégie de personnalisation et de contextualisation des résultats de recherche. Cela va-t-il changer nos habitudes de recherche et les techniques SEO actuellement employées ?
 Par Philippe Yonnet
Par Philippe YonnetC’est Marissa Meyer, à l’époque où elle était à la tête de Yahoo, qui a popularisé le concept de « moteur de recherche contextuel » en le présentant comme le cheval de bataille chez Yahoo ! pour réaliser des outils de recherche innovants capables de remettre sa société dans la course.
De quoi s’agit-il ? Tout simplement d’un moteur qui est capable de deviner, en fonction des données de contexte dont il dispose, ce que l’utilisateur recherche, et donc de délivrer une page de résultats plus pertinente. Poussée à l’extrême, cette approche permet de créer des moteurs de recherche qui fonctionnent sans que l’internaute exprime de requêtes, et surtout, sans requêtes sous forme de mots clés.
Nous allons voir dans cet article que les moteurs traditionnels essaient d’embarquer de plus en plus de fonctionnalités contextuelles. Et que des outils de recherche « contextuels » ont vu le jour. Nous nous intéresserons ensuite aux techniques qui permettent à ces moteurs de fonctionner et aux problèmes qui restent encore à résoudre. Pour finalement essayer de répondre à la question suivante : comment fait-on du SEO sur un moteur contextuel ?
La prise en compte du contexte : un rêve longtemps jugé inaccessible
Les technologies à l’œuvre dans les moteurs de recherche ont mis une trentaine d’années à mûrir, de la fin des années 60 à la fin des années 90. A l’époque du lancement d’Altavista (le moteur le plus populaire avant l’apparition de Google en 1998), on peut considérer que tous les problèmes théoriques que pose la création d’un outil de recherche avaient été posés.
Parmi ces problèmes, le plus ardu était de « comprendre » la requête de l’utilisateur. Si l’utilisateur tape le mot « jaguar », que veut-il exactement ? Acheter une voiture de marque « Jaguar » ? Ou des informations sur un félidé d’Amérique du Sud ? Dans les moteurs de recherche de l’époque, c’était impossible à déterminer. Les chercheurs savaient que pour résoudre ce problème, la solution consistait à exploiter des informations de contexte :
- Qui pose la question ?
- Quelles sont ses préférences ? Ses habitudes ?
- Où pose-t-il la question ?
- Qu’a-t-il fait auparavant ? Qu’est-il en train de faire ?
- Quelles ont été ses précédentes requêtes ?
Exploiter le contexte permet donc de désambiguïser une requête à multiple sens. C’est la première utilisation que l’on peut faire du contexte.
Fig. 1. Désambiguïser une requête comme « Jaguar » sans le contexte est un casse-tête.
Une solution traditionnelle est de suggérer des requêtes plus précises à l’internaute.
Ici un exemple avec la fonctionnalité de suggestions de requêtes de Bing.
Phlippe Yonnet
Directeur Général de l’agence Search-Foresight, groupe My Media (http://www.search-foresight.com)
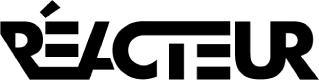


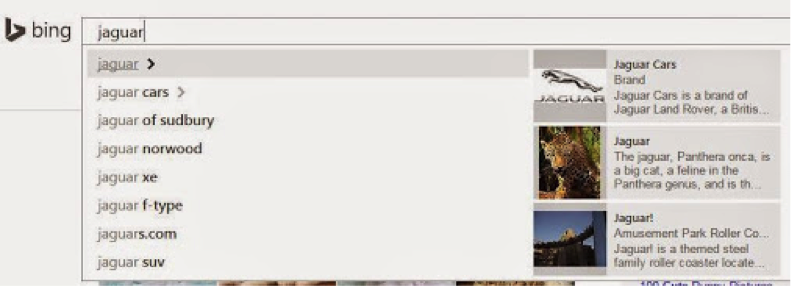


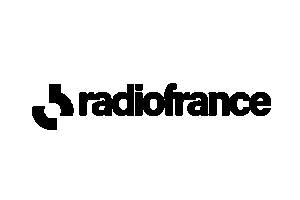


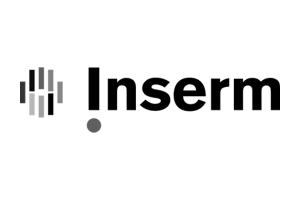






![Copyright Trolling en France : comprendre et contrôler les abus d’une pratique controversée [Partie 2] - Stéphanie Barge](https://www.reacteur.com/content/uploads/2024/05/2024-05-reacteur-stephanie-barge.png)
![Copyright Trolling en France : comprendre et contrôler les abus d’une pratique controversée [Partie 1]- Stéphanie Barge](https://www.reacteur.com/content/uploads/2024/04/2024-04-reacteur-stephanie-barge.png)


